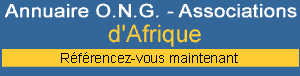La langue de la nourriture, des aliments et de l’art culinaire au Congo-Brazzaville, Jean-Alexis Mfoutou
Jean-Alexis Mfoutou est un auteur prolifique et polyvalent. Au fil des années, l’universitaire confirme son intérêt pour la recherche. Ses travaux lui permettent d’allier sa passion pour la linguistique à ses penchants pour les études sociologiques. Continuellement, ce « faiseur de mots » observe minutieusement les maux de ses concitoyens ainsi que les mœurs dans le pays de ses ancêtres pour offrir aux lecteurs des aventures aussi singulières qu'enrichissantes. Le Congo-Brazzaville, – pays d’origine de l’auteur – est une source d'inspiration qui revient souvent dans ses œuvres. La plus récente, publiée chez L’Harmattan en France, s’intitule La langue de la nourriture, des aliments et de l’art culinaire au Congo-Brazzaville.
Jean-Alexis Mfoutou a eu l'amabilité de nous accorder une exceptionnelle interview.
Propos recueillis par Ghislaine Sathoud
1) Permettez-moi de vous féliciter pour votre remarquable production scientifique. Vous faites toujours mention de votre pays d’origine, le Congo-Brazzaville, et ce, malgré le fait que vous n'y résidez plus depuis fort longtemps. Est-ce un regain d’esprit patriotique ou s’agit-il d’un geste inconscient qui confirme tout de même l'idée selon laquelle les migrants – indépendamment du motif de départ – sont tourmentés par une nostalgie incurable ?
Ce n’est pas là une question à laquelle je puisse répondre en peu de mots. Je relève ce mot « nostalgie ». Plus que de la nostalgie, de l’ « affection », car c’est de cela qu’il s’agit. Le terrain qui compte pour le chercheur, c’est d’abord de l’affection qu’il éprouve pour ce dernier. C’est à partir d’un sentiment de la sorte, irraisonné, que le chercheur éprouve le besoin de mieux le connaître et qu’alors il peut s’instruire auprès de lui. Travailler sur le Congo, parler constamment du Congo c’est tout simplement – que j’avoue cela ou que je le cache –, une façon de tirer parti de ce que le hasard de la vie me propose. Je vis certes loin de mon Congo natal, mais le Congo n’a jamais cessé de m’habiter, de m’accompagner tout au long de ma vie, je ressens pour lui une affection particulière.
2) Vous êtes l’auteur de plusieurs ouvrages, qui tournent souvent sur le langage. Votre récente publication, qui est une exploration du langage culinaire, étonne par sa flamme, sa fulgurance. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette nouvelle trajectoire?
Oui, je viens de publier chez l’Harmattan, La langue de la nourriture, des aliments et de l’art culinaire au Congo-Brazzaville. Aimer un pays, un peuple, une culture, c’est aussi aimer ses langues, c’est aussi aimer sa nourriture, sa cuisine. Ce livre pose quelques questions fort simples et tente d’y répondre : comment le francophone congolais parle-t-il de l’art de la table ? Comment nomme-t-il ce qu’il boit et mange ? Parle-t-il comme dans un livre ? En face de cette langue idéalisée, la langue quotidienne change autant avec les individus qu’avec les circonstances de la vie, et surtout, elle varie d’un domaine notionnel à un autre. Une « flamme », une « fulgurance » ? Il est vrai que c’est exaltant quand on est gourmand de parler de nourriture. Il est encore plus exaltant de passer à table. Ce livre dit peut-être tout cela. Une « flamme », une « fulgurance » ? Je venais de découvrir en explorant le domaine de la nourriture, des aliments et de l’art culinaire, ce que cache le désordre apparent des mots de tous les jours : il y a en effet dans les mots de la vie, un rythme, une cohérence qui peut prendre le pas sur l’histoire, les événements, les représentations et faire apparaître du vrai au point de révéler une vague d’images. Clef de lecture pour comprendre un univers donné, le mot semble se caractériser par cette énergie et cette explosion du désir et du souvenir qui passent d’une image à une autre. La « flamme », la « fulgurance » que vous évoquez sont précisément celles des mots, du langage, du sujet parlant. Le lexique étudié ici montre par exemple qu’il ne connaît pas les frontières en ce qu’il permet de passer d’un domaine notionnel à un autre. Et ce livre montre comment le sujet parlant prend formellement acte de cette inconstance des mots qui, située au centre même du langage humain, dit cette dialectique du réel et du désir.
3) En fait, vous adaptez le langage à différentes problématiques. L’un de vos ouvrages était consacré à la perception du langage du point de vue de la sorcellerie ; cette fois vous vous intéressez à l’art culinaire. D'où vient donc cet intérêt pour l’art culinaire qui est dans les us et coutumes du Congo une activité réservée aux femmes ?
L’art dit culinaire est ouvert à tous ceux qui souhaitent développer une histoire à partir de recettes, de divers mets. Autrement dit, non pas que je n’ai pas voulu de cette forme de connaissance qui consiste à dire que la cuisine est une activité davantage réservée aux femmes, mais j’ai voulu passer à une lecture de l’art de la table qui opère des synthèses en ce que tout et tous s’y retrouvent : la paix, la guerre, les hommes, les femmes, les enfants, les adultes, les riches, les pauvres, etc.
4) Alors peut-on dire que cette publication est un changement de cap dans votre cheminement de chercheur ?
Que je parle de la sorcellerie, du fait divers ou de l’art culinaire, je reste et demeure dans la recherche de la compréhension de l’Homme, de son environnement, de sa culture. Tout ce que l’Homme voit, touche, sent, imagine, boit, mange, tout ce dont il rêve nécessite un langage, un emploi de mots ; et chaque mot désigne un aspect ou un élément de l’Homme. La manière de boire, de cuire les aliments, de manger n’est qu’un aspect de l’Homme, de même nature que la puissance et la pertinence que son langage. Cette publication est une autre approche, une autre ouverture où transparaît le mystère ténébreux de l’homme de paroles, de son environnement, de sa culture, de son langage.
5) Cet ouvrage est une histoire de la nourriture… Ce qui est très intéressant, c’est que dans votre démarche interagissent plusieurs autres aspects du quotidien (sport, technologie, relations sociales, etc.). Au fond, tout le monde trouve son compte selon ses passions ?
Oui, sans doute, car qu’on le veuille ou non, chacun à un moment ou à un autre passe à table. La table, en tout cas je crois l’avoir découvert en écrivant ce livre est un moment de confluence, une interface, un lieu de partage aussi : partage du pain certes, mais aussi partage de la parole, partage de soi aussi en tant que sportif, technicien, membre de telle ou telle communauté, etc. A table, chaque évocation s’enrichit des significations orientées à la fois vers un ici qu’est la table et vers un là-bas, un autre contexte et un autre lieu qu’est par exemple le sport pratiqué par ailleurs. L’art de la table est véritablement lié à la plénitude de tous et de chacun, à la plénitude de soi.
6) Vous mettez l’accent sur les mots qui prennent des significations différentes selon le contexte d'utilisation… Pouvez-vous nous donner les sens des mots aubergine, barricades et nzenga, pour ne citer que ceux-là ?
– Ce qui m’attire dans les mots, c’est leur vie, ce sont les petits secrets qu’ils nous livrent. A un mot en effet, ne correspond jamais une chose et une seule. Sous la voix d’un mot dans un contexte donné, murmure ou quelquefois crie, hurle une autre voix, celle d’un autre contexte, celle d’une culture, celle de son passé, celle d’une histoire. Pour la raison qu’il serait trop long – dans le cadre de cet entretien qui n’est que trop rapide, puisqu’il faut répondre dans l’urgence –, de parler de tous ces termes qui attestent d’une évolution sémantique, porteurs de conflits, de contradictions, de tension, de consensus provisoires, de coexistence momentanée, d’échanges dynamiques, du fait de l’effervescence du réel extralinguistique. Contentons-nous plutôt de raconter à grand trait et à partir d’un exemple, cet aspect passionnant de la vie du langage humain.
Le mot aubergine par exem
Jean-Alexis Mfoutou a eu l'amabilité de nous accorder une exceptionnelle interview.
Propos recueillis par Ghislaine Sathoud
1) Permettez-moi de vous féliciter pour votre remarquable production scientifique. Vous faites toujours mention de votre pays d’origine, le Congo-Brazzaville, et ce, malgré le fait que vous n'y résidez plus depuis fort longtemps. Est-ce un regain d’esprit patriotique ou s’agit-il d’un geste inconscient qui confirme tout de même l'idée selon laquelle les migrants – indépendamment du motif de départ – sont tourmentés par une nostalgie incurable ?
Ce n’est pas là une question à laquelle je puisse répondre en peu de mots. Je relève ce mot « nostalgie ». Plus que de la nostalgie, de l’ « affection », car c’est de cela qu’il s’agit. Le terrain qui compte pour le chercheur, c’est d’abord de l’affection qu’il éprouve pour ce dernier. C’est à partir d’un sentiment de la sorte, irraisonné, que le chercheur éprouve le besoin de mieux le connaître et qu’alors il peut s’instruire auprès de lui. Travailler sur le Congo, parler constamment du Congo c’est tout simplement – que j’avoue cela ou que je le cache –, une façon de tirer parti de ce que le hasard de la vie me propose. Je vis certes loin de mon Congo natal, mais le Congo n’a jamais cessé de m’habiter, de m’accompagner tout au long de ma vie, je ressens pour lui une affection particulière.
2) Vous êtes l’auteur de plusieurs ouvrages, qui tournent souvent sur le langage. Votre récente publication, qui est une exploration du langage culinaire, étonne par sa flamme, sa fulgurance. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette nouvelle trajectoire?
Oui, je viens de publier chez l’Harmattan, La langue de la nourriture, des aliments et de l’art culinaire au Congo-Brazzaville. Aimer un pays, un peuple, une culture, c’est aussi aimer ses langues, c’est aussi aimer sa nourriture, sa cuisine. Ce livre pose quelques questions fort simples et tente d’y répondre : comment le francophone congolais parle-t-il de l’art de la table ? Comment nomme-t-il ce qu’il boit et mange ? Parle-t-il comme dans un livre ? En face de cette langue idéalisée, la langue quotidienne change autant avec les individus qu’avec les circonstances de la vie, et surtout, elle varie d’un domaine notionnel à un autre. Une « flamme », une « fulgurance » ? Il est vrai que c’est exaltant quand on est gourmand de parler de nourriture. Il est encore plus exaltant de passer à table. Ce livre dit peut-être tout cela. Une « flamme », une « fulgurance » ? Je venais de découvrir en explorant le domaine de la nourriture, des aliments et de l’art culinaire, ce que cache le désordre apparent des mots de tous les jours : il y a en effet dans les mots de la vie, un rythme, une cohérence qui peut prendre le pas sur l’histoire, les événements, les représentations et faire apparaître du vrai au point de révéler une vague d’images. Clef de lecture pour comprendre un univers donné, le mot semble se caractériser par cette énergie et cette explosion du désir et du souvenir qui passent d’une image à une autre. La « flamme », la « fulgurance » que vous évoquez sont précisément celles des mots, du langage, du sujet parlant. Le lexique étudié ici montre par exemple qu’il ne connaît pas les frontières en ce qu’il permet de passer d’un domaine notionnel à un autre. Et ce livre montre comment le sujet parlant prend formellement acte de cette inconstance des mots qui, située au centre même du langage humain, dit cette dialectique du réel et du désir.
3) En fait, vous adaptez le langage à différentes problématiques. L’un de vos ouvrages était consacré à la perception du langage du point de vue de la sorcellerie ; cette fois vous vous intéressez à l’art culinaire. D'où vient donc cet intérêt pour l’art culinaire qui est dans les us et coutumes du Congo une activité réservée aux femmes ?
L’art dit culinaire est ouvert à tous ceux qui souhaitent développer une histoire à partir de recettes, de divers mets. Autrement dit, non pas que je n’ai pas voulu de cette forme de connaissance qui consiste à dire que la cuisine est une activité davantage réservée aux femmes, mais j’ai voulu passer à une lecture de l’art de la table qui opère des synthèses en ce que tout et tous s’y retrouvent : la paix, la guerre, les hommes, les femmes, les enfants, les adultes, les riches, les pauvres, etc.
4) Alors peut-on dire que cette publication est un changement de cap dans votre cheminement de chercheur ?
Que je parle de la sorcellerie, du fait divers ou de l’art culinaire, je reste et demeure dans la recherche de la compréhension de l’Homme, de son environnement, de sa culture. Tout ce que l’Homme voit, touche, sent, imagine, boit, mange, tout ce dont il rêve nécessite un langage, un emploi de mots ; et chaque mot désigne un aspect ou un élément de l’Homme. La manière de boire, de cuire les aliments, de manger n’est qu’un aspect de l’Homme, de même nature que la puissance et la pertinence que son langage. Cette publication est une autre approche, une autre ouverture où transparaît le mystère ténébreux de l’homme de paroles, de son environnement, de sa culture, de son langage.
5) Cet ouvrage est une histoire de la nourriture… Ce qui est très intéressant, c’est que dans votre démarche interagissent plusieurs autres aspects du quotidien (sport, technologie, relations sociales, etc.). Au fond, tout le monde trouve son compte selon ses passions ?
Oui, sans doute, car qu’on le veuille ou non, chacun à un moment ou à un autre passe à table. La table, en tout cas je crois l’avoir découvert en écrivant ce livre est un moment de confluence, une interface, un lieu de partage aussi : partage du pain certes, mais aussi partage de la parole, partage de soi aussi en tant que sportif, technicien, membre de telle ou telle communauté, etc. A table, chaque évocation s’enrichit des significations orientées à la fois vers un ici qu’est la table et vers un là-bas, un autre contexte et un autre lieu qu’est par exemple le sport pratiqué par ailleurs. L’art de la table est véritablement lié à la plénitude de tous et de chacun, à la plénitude de soi.
6) Vous mettez l’accent sur les mots qui prennent des significations différentes selon le contexte d'utilisation… Pouvez-vous nous donner les sens des mots aubergine, barricades et nzenga, pour ne citer que ceux-là ?
– Ce qui m’attire dans les mots, c’est leur vie, ce sont les petits secrets qu’ils nous livrent. A un mot en effet, ne correspond jamais une chose et une seule. Sous la voix d’un mot dans un contexte donné, murmure ou quelquefois crie, hurle une autre voix, celle d’un autre contexte, celle d’une culture, celle de son passé, celle d’une histoire. Pour la raison qu’il serait trop long – dans le cadre de cet entretien qui n’est que trop rapide, puisqu’il faut répondre dans l’urgence –, de parler de tous ces termes qui attestent d’une évolution sémantique, porteurs de conflits, de contradictions, de tension, de consensus provisoires, de coexistence momentanée, d’échanges dynamiques, du fait de l’effervescence du réel extralinguistique. Contentons-nous plutôt de raconter à grand trait et à partir d’un exemple, cet aspect passionnant de la vie du langage humain.
Le mot aubergine par exem



 3296
3296  0
0