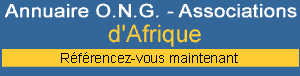Ségolène Royal à l’université de Montréal. Intégrer les migrants dans l’harmonie des différences
Le Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal accueillait le mercredi 19 septembre 2007 Ségolène Royale, candidate socialiste aux dernières élections présidentielles françaises. Plusieurs Montréalais étaient de la partie : des étudiants, des professeurs mais aussi des curieux qui voulaient écouter son allocution. À l’ordre du jour, plusieurs thèmes : les débats actuels au Québec sur l’intégration des immigrants, ces « accommodements raisonnables », les questions environnementales, les questions internationales.
Actuellement le débat sur l’immigration est plus que d’actualité au Québec. Il est question d’établir des prévisions sur l’immigration. La province a besoin de nouveaux arrivants pour faire face au vieillissement de la population…
Par ailleurs, l’immigration c’est aussi la cohabitation des cultures différentes voire même opposées. À propos des différences, elles sont énormes. Elles attisent les débats et réveillent des passions. Certains soutiennent que les nouveaux arrivants doivent se soumettre à des règles précises pour « réussir l’intégration » dans la société d’accueil.
D’autres clament haut et fort qu’il faut garder quelque chose de la culture d’origine. Et pour eux, la cohabitation entre différentes cultures rime avec le respect des autres cultures, des valeurs des uns et des autres. Ainsi, la « liberté » est évoquée pour justifier le refus d’abandonner les us et coutumes du pays d’origine. De ce fait, la notion « d’intégration » porte les germes de « l’assimilation » selon les partisans d’un « conservatisme » qui veulent garder quelque chose du pays d’origine.
Il faut dire que la perception de l’intégration est différente. Tout autant que celle de l’assimilation d’ailleurs !
Alors, comment définir cette « liberté » ? Elle est du reste réclamée ardemment… Jusqu’où faut-il tolérer la liberté ? Qu’est-ce que la liberté dans une vie publique qui implique tout le monde ? Et la place de la communauté dans tout ça, le respect des autres ?
Plusieurs interrogations se greffent à cette notion qui est au cœur de l’argumentation des réfractaires au changement. Le sujet fait couler de l’encre. La société québécoise est multiculturelle et il faut tenir compte de cette diversité pour une cohabitation harmonieuse. La classe politique se mobilise également.
Ségolène Royal s’est d’ailleurs exprimée sur ce sujet : « Les questions aujourd’hui en débat au Québec autour de ce qu’on y appelle les accommodements raisonnables me paraissent essentielles. Ce sont des questions que se posent toutes les nations, toutes les sociétés que les vagues migratoires, la soif croissante des individus et les effets de la mondialisation poussent à actualiser leurs valeurs communes et leurs règles de vie ».
Une chose est certaine, cette question est incontournable et récurrente partout. La mixité de la population mondiale justifie l’intérêt de se pencher sur cet aspect important qui peut causer de grands bouleversements si l’on n’y prend garde.
Pour renforcer la sécurité collective
Peut-on encore éviter la question de l’environnement avec toutes les alertes, tous ces signaux qui annoncent des catastrophes futures ? La nature s’exprime et interpelle les consciences. Des actions sont menées pour sensibiliser le monde sur les questions environnementales. D’ailleurs, pour répondre à ces alertes, une prise de conscience collective est indispensable.
Ségolène Royal a affirmé : « Je sais que le Canada et la France n’ont pas fait le même choix face au protocole de Kyoto mais, depuis, la prise de conscience écologique s’est partout renforcée. Le monde a besoin du Canada. »
Le moins que l’on puisse est que la question des réchauffements climatiques est importante et dramatique. L’adhésion à cette cause est une volonté de s’engager dans le combat de la « sécurité collective ». C’est donc à juste titre que le sujet suscite de nombreux débats.
Une union au-delà des différences
La francophon
Actuellement le débat sur l’immigration est plus que d’actualité au Québec. Il est question d’établir des prévisions sur l’immigration. La province a besoin de nouveaux arrivants pour faire face au vieillissement de la population…
Par ailleurs, l’immigration c’est aussi la cohabitation des cultures différentes voire même opposées. À propos des différences, elles sont énormes. Elles attisent les débats et réveillent des passions. Certains soutiennent que les nouveaux arrivants doivent se soumettre à des règles précises pour « réussir l’intégration » dans la société d’accueil.
D’autres clament haut et fort qu’il faut garder quelque chose de la culture d’origine. Et pour eux, la cohabitation entre différentes cultures rime avec le respect des autres cultures, des valeurs des uns et des autres. Ainsi, la « liberté » est évoquée pour justifier le refus d’abandonner les us et coutumes du pays d’origine. De ce fait, la notion « d’intégration » porte les germes de « l’assimilation » selon les partisans d’un « conservatisme » qui veulent garder quelque chose du pays d’origine.
Il faut dire que la perception de l’intégration est différente. Tout autant que celle de l’assimilation d’ailleurs !
Alors, comment définir cette « liberté » ? Elle est du reste réclamée ardemment… Jusqu’où faut-il tolérer la liberté ? Qu’est-ce que la liberté dans une vie publique qui implique tout le monde ? Et la place de la communauté dans tout ça, le respect des autres ?
Plusieurs interrogations se greffent à cette notion qui est au cœur de l’argumentation des réfractaires au changement. Le sujet fait couler de l’encre. La société québécoise est multiculturelle et il faut tenir compte de cette diversité pour une cohabitation harmonieuse. La classe politique se mobilise également.
Ségolène Royal s’est d’ailleurs exprimée sur ce sujet : « Les questions aujourd’hui en débat au Québec autour de ce qu’on y appelle les accommodements raisonnables me paraissent essentielles. Ce sont des questions que se posent toutes les nations, toutes les sociétés que les vagues migratoires, la soif croissante des individus et les effets de la mondialisation poussent à actualiser leurs valeurs communes et leurs règles de vie ».
Une chose est certaine, cette question est incontournable et récurrente partout. La mixité de la population mondiale justifie l’intérêt de se pencher sur cet aspect important qui peut causer de grands bouleversements si l’on n’y prend garde.
Pour renforcer la sécurité collective
Peut-on encore éviter la question de l’environnement avec toutes les alertes, tous ces signaux qui annoncent des catastrophes futures ? La nature s’exprime et interpelle les consciences. Des actions sont menées pour sensibiliser le monde sur les questions environnementales. D’ailleurs, pour répondre à ces alertes, une prise de conscience collective est indispensable.
Ségolène Royal a affirmé : « Je sais que le Canada et la France n’ont pas fait le même choix face au protocole de Kyoto mais, depuis, la prise de conscience écologique s’est partout renforcée. Le monde a besoin du Canada. »
Le moins que l’on puisse est que la question des réchauffements climatiques est importante et dramatique. L’adhésion à cette cause est une volonté de s’engager dans le combat de la « sécurité collective ». C’est donc à juste titre que le sujet suscite de nombreux débats.
Une union au-delà des différences
La francophon



 103
103  0
0