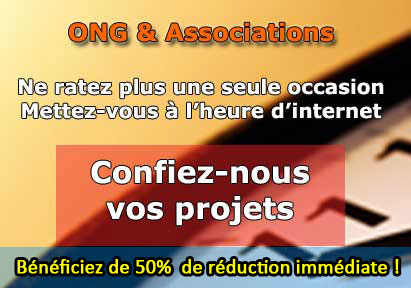Côte d'Ivoire: Dr Mamadou Fofana -
Dr Fofana Mamadou est spécialiste en télédétection et systèmes d'information géographique (cartographie numérique). Coordinateur national du Fonds commun des produits de base au Ministère de l'Agriculture, il est par ailleurs le président de la "commission environnement et développement" du RDR. C'est à ce titre qu'il a bien voulu nous éclairer sur l'impact des déchets toxiques sur l'environnement.
Quel souvenir vous rappelle le Probro Koala ?
Le Probo Koala me rappelle Tchernobyl. Cela me rappelle l'inconscience des gens vis-à-vis de l'environnement et du futur. Le Probo Koala renvoie aussi à la pauvreté, parce qu'il n'y a qu'un pays pauvre qui puisse accepter d'accueillir les déchets de ce bateau. Le Probo Koala, c'est en conclusion, un symbole de malheur, d'inconscience et la recherche du gain facile.
Les déchets ont causé la souffrance et la mort de beaucoup de personnes. Pensez-vous qu'on aurait pu éviter ce drame à la Côte d'Ivoire ?
C'est une question de conscience. Pour moi, ce drame aurait pu être évité si dès le départ, le traitement avait été fait dans la transparence. Le Probo Koala n'a pas chargé à Amsterdam pour venir directement à Abidjan. Il a eu un itinéraire et son contenu n'était pas méconnu contrairement à ce qu'on veut faire croire. Sinon, l'on n'aurait pas cherché à le déverser nuitamment. Je pense donc qu'on aurait pu éviter à la Côte d'Ivoire ce drame, parce que le Probo Koala n'est pas une génération spontanée.
On s'est beaucoup appesanti jusque-là sur les conséquences sanitaires mais l'environnement n'en a pas moins souffert. Qu'en est-il de l'impact de ces déchets sur la nature ?
A l'analyse de la composition chimique des déchets, cela amène à réfléchir. Car c'est de la soude, de l'hydrogène sulfuré et de l'acide caustique etc. On n'a pas affaire à des éléments qui sont inhalés et oubliés le lendemain. Ces éléments ont d'abord des conséquences sur l'organisme humain mais aussi dans la nature. Quand nous sommes dans une zone sédimentaire où il n'y a pas de rochers à fleur le sol, c'est-à-dire dans une zone sablonneuse, les déchets vont s'infiltrer et atteindre la nappe phréatique qui est la réserve d'eau souterraine que nous buvons. Il y a donc de réels risques. Mais la conséquence première, ce sont les plantes. Les plantes, c'est comme l'homme. Elles vivent grâce à des éléments chimiques qui sont dans le sol.
Si les éléments chimiques qui sont dans le sol ne sont pas faits pour sa nutrition, il y aura, soit un déficit d'éléments, soit une attaque des éléments vitaux de la plante. Et s'il se trouve que ces plantes sont comestibles par l'homme, il y a des risques d'une intoxication. C'est encore grave. Le drame dans la gestion de ces déchets, c'est qu'on a demandé un certain nombre d'analyses dont on n'a pas encore les résultats. Il s'agit notamment, des analyses radioactives. Il faut qu'on sache si ces déchets sont radioactifs. S'il s'avérait qu'ils le sont, alors c'est très grave. Parce que les éléments radioactifs ne se désintègrent pas facilement. La désintégration des éléments radioactifs dure au moins 120 ans. Pendant ce temps, la population va souffrir de beaucoup de pathologies comme les problèmes de reins, du cancer, et même de problèmes sexuels. Tous les chromosomes qui constituent la carte génétique de l'homme vont être touchés et vont causer des malformations et introduire des mutations. Et c'est très grave pour que rien ne soit fait pour circonscrire le mal dès maintenant.
Les cultures ont repris dans les environs des sites du déversement des déchets toxiques. Y a-t-il des risques ?
C'est ce qu'on appelle l'inconscience. L'équilibre écologique n'est pas retrouvé. Et ceux qui pratiquent encore des cultures dans les environs des sites concernés exposent la population à des conséquences graves. Parce que le milieu n'est pas sain. Il aurait été bon que cette zone soit d'abord déclarée sans risque après des études sur les sites avant que les cultures ne reprennent. Malheureusement, ces personnes qui s'adonnent à cette culture sont pauvres et ont besoin de ce travail pour vivre.
Si la nappe phréatique est touchée, quelle peut être la portée néfaste sur la population ?
Il faut d'abord préciser qu'il n'y a pas qu'une seule nappe phréatique à Abidjan. Il s'agit de poches d'eau dans le sol. C'est-à-dire que l'eau qu'on boit à Yopougon n'a pas forcement la même provenance que l'eau qu'on boit à Cocody. Tout Abidjan ne puise donc pas dans la même nappe. Les analyses doivent par conséquence être portées sur les sites où il y a eu dépôt des déchets toxiques de sorte que l'on sache si ces eaux sont encore utilisables ou non. A ce niveau, il convient de préciser que l'eau de la Sodéci subissant des traitements, il va sans dire que le risque de contamination est moindre. Par contre, les plantes n'ont pas de robinet, elles prennent l'eau directement dans le sol. C'est-à-dire que les plantes comme la salade, le maïs peuvent être contaminés et représentés une menace sur la santé de la population.
Que préconisez-vous en tant que spécialiste de l'environnement dans la gestion à long terme ?
Nous proposons d'abord qu'il y ait une cartographie détaillée des zones de déversement de ces déchets. Ensuite, il faut faire un relevé radioactif. Il suffit de faire des tours en hélicoptère au dessus des zones touchées avec l'équipement indiqué en vue de détecter la radioactivité. Une fois qu'on a ces éléments, les mesures qui s'imposent doivent être prises. Ce qui n'a pas été fait. C'est pourtant une précaution primaire.
Cela est-il de la responsabilité du gouvernement?
Oui, bien sûr que c'est de la responsabilité de l'Etat notamment de ses démembrements. Mais il faut reconnaître que l'Etat ne peut pas tout faire. Je pense au district et aux communes qui sont les premiers touchés et qui devaient se mobiliser pour ce travail.
En dehors même des déchets toxiques, la pollution a atteint un seuil inquiétant en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que notre système de canalisation et de drainage des eaux usées est adapté?
En ce qui concerne la ville d'Abidjan, le problème de canalisation demeure. Le schéma directeur de canalisation des eaux est tout simplement inexistant. Nous avons des égouts qui sont totalement obstrués. En ce qui concerne les ordures aussi, il y a un problème de classification à faire. A savoir, séparer les déchets ménagers des déchets médicaux et industriels. La pré collecte est défaillante aussi bien que le traitement. Tout part de la canalisation, or nous avons des dimensions qui ont été faites sur la base d'un million d'habitants pour Abidjan qui est aujourd'hui à plus de cinq millions. La production des déchets a donc augmenté, les caniveaux dépassés et non entretenus. Tout le système doit être repensé.
On ne saurait évoquer l'environnement sans parler du changement climatique. A quoi est dû ce phénomène ?
Quand vous prenez la carte du monde, l'Afrique de l'ouest emboîte parfaitement dans le continent Américain. A l'époque, ils formaient un seul continent qu'on appelait le Gondwana. L'expérience de Gondwana nous démontre que tous les 100 ans, l'Amérique et l'Afrique s'éloignent d'un centimètre. Cela nous donne un peu l'âge de la mer, de l'océan atlantique qui nous sépare. Ensuite, il y a l'émission des gaz à effet de serre qui augmente la température dans l'air. Ce qui a une incidence sur les blocs de glace qui se fondent en entraînant une augmentation du niveau de la mer.
C'est la production croissante de la chaleur qui pose aujourd'hui problème. Quand les eaux montent, il va sans dire que les endroits qui ne sont pas faits pour être habités, vont connaître une inondation. C'est ce qui cause des phénomènes de désastre que nous observons un peu partout dans le monde. Avec la montée des eaux, on constate que les zones qui étaient relativement sèches deviennent humides. Et comme les infrastructures de certains pays ne sont pas adaptées à l'humidité, on assiste à des désastr
Quel souvenir vous rappelle le Probro Koala ?
Le Probo Koala me rappelle Tchernobyl. Cela me rappelle l'inconscience des gens vis-à-vis de l'environnement et du futur. Le Probo Koala renvoie aussi à la pauvreté, parce qu'il n'y a qu'un pays pauvre qui puisse accepter d'accueillir les déchets de ce bateau. Le Probo Koala, c'est en conclusion, un symbole de malheur, d'inconscience et la recherche du gain facile.
Les déchets ont causé la souffrance et la mort de beaucoup de personnes. Pensez-vous qu'on aurait pu éviter ce drame à la Côte d'Ivoire ?
C'est une question de conscience. Pour moi, ce drame aurait pu être évité si dès le départ, le traitement avait été fait dans la transparence. Le Probo Koala n'a pas chargé à Amsterdam pour venir directement à Abidjan. Il a eu un itinéraire et son contenu n'était pas méconnu contrairement à ce qu'on veut faire croire. Sinon, l'on n'aurait pas cherché à le déverser nuitamment. Je pense donc qu'on aurait pu éviter à la Côte d'Ivoire ce drame, parce que le Probo Koala n'est pas une génération spontanée.
On s'est beaucoup appesanti jusque-là sur les conséquences sanitaires mais l'environnement n'en a pas moins souffert. Qu'en est-il de l'impact de ces déchets sur la nature ?
A l'analyse de la composition chimique des déchets, cela amène à réfléchir. Car c'est de la soude, de l'hydrogène sulfuré et de l'acide caustique etc. On n'a pas affaire à des éléments qui sont inhalés et oubliés le lendemain. Ces éléments ont d'abord des conséquences sur l'organisme humain mais aussi dans la nature. Quand nous sommes dans une zone sédimentaire où il n'y a pas de rochers à fleur le sol, c'est-à-dire dans une zone sablonneuse, les déchets vont s'infiltrer et atteindre la nappe phréatique qui est la réserve d'eau souterraine que nous buvons. Il y a donc de réels risques. Mais la conséquence première, ce sont les plantes. Les plantes, c'est comme l'homme. Elles vivent grâce à des éléments chimiques qui sont dans le sol.
Si les éléments chimiques qui sont dans le sol ne sont pas faits pour sa nutrition, il y aura, soit un déficit d'éléments, soit une attaque des éléments vitaux de la plante. Et s'il se trouve que ces plantes sont comestibles par l'homme, il y a des risques d'une intoxication. C'est encore grave. Le drame dans la gestion de ces déchets, c'est qu'on a demandé un certain nombre d'analyses dont on n'a pas encore les résultats. Il s'agit notamment, des analyses radioactives. Il faut qu'on sache si ces déchets sont radioactifs. S'il s'avérait qu'ils le sont, alors c'est très grave. Parce que les éléments radioactifs ne se désintègrent pas facilement. La désintégration des éléments radioactifs dure au moins 120 ans. Pendant ce temps, la population va souffrir de beaucoup de pathologies comme les problèmes de reins, du cancer, et même de problèmes sexuels. Tous les chromosomes qui constituent la carte génétique de l'homme vont être touchés et vont causer des malformations et introduire des mutations. Et c'est très grave pour que rien ne soit fait pour circonscrire le mal dès maintenant.
Les cultures ont repris dans les environs des sites du déversement des déchets toxiques. Y a-t-il des risques ?
C'est ce qu'on appelle l'inconscience. L'équilibre écologique n'est pas retrouvé. Et ceux qui pratiquent encore des cultures dans les environs des sites concernés exposent la population à des conséquences graves. Parce que le milieu n'est pas sain. Il aurait été bon que cette zone soit d'abord déclarée sans risque après des études sur les sites avant que les cultures ne reprennent. Malheureusement, ces personnes qui s'adonnent à cette culture sont pauvres et ont besoin de ce travail pour vivre.
Si la nappe phréatique est touchée, quelle peut être la portée néfaste sur la population ?
Il faut d'abord préciser qu'il n'y a pas qu'une seule nappe phréatique à Abidjan. Il s'agit de poches d'eau dans le sol. C'est-à-dire que l'eau qu'on boit à Yopougon n'a pas forcement la même provenance que l'eau qu'on boit à Cocody. Tout Abidjan ne puise donc pas dans la même nappe. Les analyses doivent par conséquence être portées sur les sites où il y a eu dépôt des déchets toxiques de sorte que l'on sache si ces eaux sont encore utilisables ou non. A ce niveau, il convient de préciser que l'eau de la Sodéci subissant des traitements, il va sans dire que le risque de contamination est moindre. Par contre, les plantes n'ont pas de robinet, elles prennent l'eau directement dans le sol. C'est-à-dire que les plantes comme la salade, le maïs peuvent être contaminés et représentés une menace sur la santé de la population.
Que préconisez-vous en tant que spécialiste de l'environnement dans la gestion à long terme ?
Nous proposons d'abord qu'il y ait une cartographie détaillée des zones de déversement de ces déchets. Ensuite, il faut faire un relevé radioactif. Il suffit de faire des tours en hélicoptère au dessus des zones touchées avec l'équipement indiqué en vue de détecter la radioactivité. Une fois qu'on a ces éléments, les mesures qui s'imposent doivent être prises. Ce qui n'a pas été fait. C'est pourtant une précaution primaire.
Cela est-il de la responsabilité du gouvernement?
Oui, bien sûr que c'est de la responsabilité de l'Etat notamment de ses démembrements. Mais il faut reconnaître que l'Etat ne peut pas tout faire. Je pense au district et aux communes qui sont les premiers touchés et qui devaient se mobiliser pour ce travail.
En dehors même des déchets toxiques, la pollution a atteint un seuil inquiétant en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que notre système de canalisation et de drainage des eaux usées est adapté?
En ce qui concerne la ville d'Abidjan, le problème de canalisation demeure. Le schéma directeur de canalisation des eaux est tout simplement inexistant. Nous avons des égouts qui sont totalement obstrués. En ce qui concerne les ordures aussi, il y a un problème de classification à faire. A savoir, séparer les déchets ménagers des déchets médicaux et industriels. La pré collecte est défaillante aussi bien que le traitement. Tout part de la canalisation, or nous avons des dimensions qui ont été faites sur la base d'un million d'habitants pour Abidjan qui est aujourd'hui à plus de cinq millions. La production des déchets a donc augmenté, les caniveaux dépassés et non entretenus. Tout le système doit être repensé.
On ne saurait évoquer l'environnement sans parler du changement climatique. A quoi est dû ce phénomène ?
Quand vous prenez la carte du monde, l'Afrique de l'ouest emboîte parfaitement dans le continent Américain. A l'époque, ils formaient un seul continent qu'on appelait le Gondwana. L'expérience de Gondwana nous démontre que tous les 100 ans, l'Amérique et l'Afrique s'éloignent d'un centimètre. Cela nous donne un peu l'âge de la mer, de l'océan atlantique qui nous sépare. Ensuite, il y a l'émission des gaz à effet de serre qui augmente la température dans l'air. Ce qui a une incidence sur les blocs de glace qui se fondent en entraînant une augmentation du niveau de la mer.
C'est la production croissante de la chaleur qui pose aujourd'hui problème. Quand les eaux montent, il va sans dire que les endroits qui ne sont pas faits pour être habités, vont connaître une inondation. C'est ce qui cause des phénomènes de désastre que nous observons un peu partout dans le monde. Avec la montée des eaux, on constate que les zones qui étaient relativement sèches deviennent humides. Et comme les infrastructures de certains pays ne sont pas adaptées à l'humidité, on assiste à des désastr

COTEIVOIRE - accès rapides
 Accueil coteivoire
Accueil coteivoire
 Actualites
Actualites
 Arts et Culture
Arts et Culture
 Cuisine
Cuisine
 Economie
Economie
 Education
Education
 Environnement
Environnement
 Musique
Musique
 Peuples - Ethnies
Peuples - Ethnies
 Politique
Politique
 Sante
Sante
 Société
Société
 Sport
Sport



 541
541  0
0