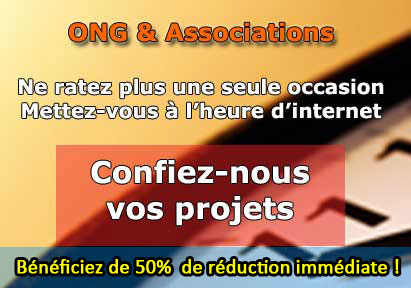Réchauffement planétaire : L’Afrique, grande oubliée des fonds

Il est généralement admis que l’Afrique, qui de toutes les régions est celle qui produit le moins de “gaz à effet de serre” à l’origine du réchauffement planétaire, aura besoin d’une importante aide financière pour remédier aux effets de ce phénomène. Mais il n’est pas aussi sûr que cette aide soit accordée. L’Afrique peine déjà à mobiliser suffisamment de fonds nécessaires pour lutter contre la pauvreté et n’a pas réussi à obtenir les investissements nécessaires aux projets de protection de l’environnement sur le continent. Bien que les dirigeants des pays du monde entier aient promis de contribuer davantage au développement, le montant de l’aide accordée a en fait baissé de plus de 5 pour cent l’an dernier.
Pauvreté et protection de l’environnement sont étroitement liés, comme le rappelle le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Il est indiqué dans le plan d’action pour l’environnement du NEPAD que “les taux de pauvreté croissants et l’accélération de la dégradation de l’environnement sont deux maux interdépendants dont souffre l’Afrique… La pauvreté demeure à la fois la première cause et conséquence de la détérioration de l’environnement et de l’épuisement des ressources en Afrique. Sans une amélioration sensible des conditions de vie et des moyens d’existence des populations du continent, les politiques et programmes en faveur de l’environnement auront peu de chances d’aboutir.”
Protéger les forêts
Les scientifiques africains estiment que le continent contribue déjà activement à la lutte contre le réchauffement planétaire, notamment grâce à ses forêts, qui absorbent et retiennent le gaz carbonique, principal facteur de réchauffement. L’Afrique compte 17 pour cent des forêts de la planète et près du quart des forêts tropicales, qui contribuent à purifier l’air des émissions polluantes produites à des milliers de kilomètres.
Mais les forêts d’Afrique disparaissent actuellement au rythme de plus de 5 millions d’hectares par an, victimes d’une exploitation commerciale excessive et non viable, et des méthodes de défrichage par brûlis. Des études indiquent que 66 millions d’hectares de forêts ont été détruits entre 1980 et 1995, et que le rythme de déforestation s’intensifie, malgré des initiatives comme le mouvement Green Belt au Kenya, une campagne menée par des femmes à l’échelle locale qui a permis de planter quelque 10 millions d’arbres depuis 1977.
Le NEPAD préconise d’appliquer des lois qui rendent l’exploitation forestière viable et d’améliorer les rendements agricoles pour ralentir le défrichage à des fins agricoles. Mais le bois constitue un produit d’exportation important pour certains pays et la réduction de ces exportations se solderait par un manque à gagner difficile, voire impossible à combler. Des pays d’Afrique et d’autres régions du monde ont demandé aux pays industrialisés de reconnaître l’importance des forêts pour l’environnement et de rémunérer les pays en développement en échange de leur préservation. À ce jour, seuls quelques programmes pilotes ont été menés à petite échelle et l’action de l’Afrique contre le changement climatique se heurte au manque de moyens financiers.
L’économie environnementale: des marchés plus verts
Même si elle est plus urgente en Afrique, la question de concilier d’urgents impératifs environnementaux et de dures réalités économiques se pose partout. Même dans les pays riches, les dépenses qu’entraîne la réduction des émissions de gaz à effet de serre ont freiné bon nombre d’initiatives. Lorsque les scientifiques expliquent qu’il serait moins coûteux d’éliminer dès à présent les émissions pour prévenir les conséquences les plus graves des changements climatiques, certains gouvernements répliquent qu’il faut procéder à des réductions plus progressives et plus modestes, étant donné le coût de ces mesures pour les entreprises et les consommateurs et les préjudices possibles pour l’économie mondiale.
Dans une étude importante réalisée en 2006 sur les aspects économiques des changements climatiques au Royaume-Uni, Sir Nicholas Stern, ancien économiste en chef à la Banque mondiale, explique que la nature même des marchés libéralisés les empêche d’être naturellement plus verts. Et de fournir l’exemple suivant: les bénéfices provenant de la production d’une tonne d’acier sont partagés par une poignée d’individus – les propriétaires de l’aciérie, les ouvriers et les actionnaires – alors que, calculé en termes d’émission de gaz à effet de serre et de dommages infligés à l’environnement, le coût de cette tonne d’acier se répartit entre des milliards de personnes dans le monde sur de nombreuses générations, sous forme de problèmes de santé, de pollution de l’air et de violents changements climatiques. Les propriétaires de l’aciérie n’ont donc guère de raisons d’augmenter leurs coûts de production de façon à réduire la pollution. “Les changements climatiques représentent la faillite la plus grave des marchés que le monde ait jamais connu”, note Sir Stern.
Toute réforme économique devra donc sanctionner plus sévèrement les pollueurs si l’on veut enrayer la progression du réchauffement planétaire. Certains ont proposé l’imposition d’une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre mais cet “impôt sur le gaz carbonique” se heurte toutefois à une vive opposition dans de nombreux pays et n’a été adopté que par une poignée de pays.
Une autre méthode de quantification de la pollution – le mécanisme d’échange des droits d’émission – a connu plus de succès depuis l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto en 1997. Ce Protocole exige des pays industriels signataires (dont seuls les Etats-Unis et l’Australie ne font pas partie) qu’ils réduisent leur production de gaz à effet de serre d’environ 5 pour cent par rapport aux niveaux des années 1990. Le Protocole a également établi le Mécanisme pour le développement propre de la Conférence-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui autorise les industries les plus polluantes à acheter des droits de pollution de pays peu polluants en échange d’investissements dans les projets écologiques de ces derniers – afin de réduire ainsi le montant des émissions à l’échelle mondiale.
Les transactions de gaz carbonique s’élèvent aujourd’hui à 22 milliards de dollars. L’Afrique espérait bénéficier du faible montant de ses émissions pour attirer les capitaux du Mécanisme pour le développement propre. Ce sera peut-être le cas, mais au milieu de l’année 2007, elle n’avait bénéficié que de moins de 2 pour cent des projets financés par le Mécanisme dans le monde. Ce manque d’intérêt s’explique, d’après les experts, par les conditions généralement peu propices aux investissements qui règnent en Afrique, notamment la pénurie d’organismes financiers et commerciaux performants et l’insuffisance des moyens administratifs et de gestion du continent.
Mais puisque l’accord de Kyoto arrive à échéance en 2012 et qu’il est maintenant prouvé que le réchauffement planétaire est plus rapide que prévu, il n’est pas impossible que le développement vert de l’Afrique profite des réformes économiques nécessaires pour lutter contre le réchauffement planétaire. “On ne dispose que de peu de temps pour enrayer la croissance des émissions de gaz à effet de serre, a déclaré à la presse en mai à Bangkok Rajendra Pachauri, qui préside l’influent Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat établi par les Nations Unies. On ne peut pas se permettre d’attendre.”
ONU Afrique Renouveau
Avis de tempête
Les répercussions des changements climatiques sur la population suscitent de plus en plus d’inquiétudes dans le monde entier, alors que des milliards de tonnes de déchets industriels polluent l’atmosphère chaque année, retenant une trop grande quantité de chaleur solaire et entraînant de dangereux bouleversements du climat et des phénomènes météorologiques de par le monde.
L’Afrique subsaharienne produit moins de 4 pour cent de ces émissions – l
Pauvreté et protection de l’environnement sont étroitement liés, comme le rappelle le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Il est indiqué dans le plan d’action pour l’environnement du NEPAD que “les taux de pauvreté croissants et l’accélération de la dégradation de l’environnement sont deux maux interdépendants dont souffre l’Afrique… La pauvreté demeure à la fois la première cause et conséquence de la détérioration de l’environnement et de l’épuisement des ressources en Afrique. Sans une amélioration sensible des conditions de vie et des moyens d’existence des populations du continent, les politiques et programmes en faveur de l’environnement auront peu de chances d’aboutir.”
Protéger les forêts
Les scientifiques africains estiment que le continent contribue déjà activement à la lutte contre le réchauffement planétaire, notamment grâce à ses forêts, qui absorbent et retiennent le gaz carbonique, principal facteur de réchauffement. L’Afrique compte 17 pour cent des forêts de la planète et près du quart des forêts tropicales, qui contribuent à purifier l’air des émissions polluantes produites à des milliers de kilomètres.
Mais les forêts d’Afrique disparaissent actuellement au rythme de plus de 5 millions d’hectares par an, victimes d’une exploitation commerciale excessive et non viable, et des méthodes de défrichage par brûlis. Des études indiquent que 66 millions d’hectares de forêts ont été détruits entre 1980 et 1995, et que le rythme de déforestation s’intensifie, malgré des initiatives comme le mouvement Green Belt au Kenya, une campagne menée par des femmes à l’échelle locale qui a permis de planter quelque 10 millions d’arbres depuis 1977.
Le NEPAD préconise d’appliquer des lois qui rendent l’exploitation forestière viable et d’améliorer les rendements agricoles pour ralentir le défrichage à des fins agricoles. Mais le bois constitue un produit d’exportation important pour certains pays et la réduction de ces exportations se solderait par un manque à gagner difficile, voire impossible à combler. Des pays d’Afrique et d’autres régions du monde ont demandé aux pays industrialisés de reconnaître l’importance des forêts pour l’environnement et de rémunérer les pays en développement en échange de leur préservation. À ce jour, seuls quelques programmes pilotes ont été menés à petite échelle et l’action de l’Afrique contre le changement climatique se heurte au manque de moyens financiers.
L’économie environnementale: des marchés plus verts
Même si elle est plus urgente en Afrique, la question de concilier d’urgents impératifs environnementaux et de dures réalités économiques se pose partout. Même dans les pays riches, les dépenses qu’entraîne la réduction des émissions de gaz à effet de serre ont freiné bon nombre d’initiatives. Lorsque les scientifiques expliquent qu’il serait moins coûteux d’éliminer dès à présent les émissions pour prévenir les conséquences les plus graves des changements climatiques, certains gouvernements répliquent qu’il faut procéder à des réductions plus progressives et plus modestes, étant donné le coût de ces mesures pour les entreprises et les consommateurs et les préjudices possibles pour l’économie mondiale.
Dans une étude importante réalisée en 2006 sur les aspects économiques des changements climatiques au Royaume-Uni, Sir Nicholas Stern, ancien économiste en chef à la Banque mondiale, explique que la nature même des marchés libéralisés les empêche d’être naturellement plus verts. Et de fournir l’exemple suivant: les bénéfices provenant de la production d’une tonne d’acier sont partagés par une poignée d’individus – les propriétaires de l’aciérie, les ouvriers et les actionnaires – alors que, calculé en termes d’émission de gaz à effet de serre et de dommages infligés à l’environnement, le coût de cette tonne d’acier se répartit entre des milliards de personnes dans le monde sur de nombreuses générations, sous forme de problèmes de santé, de pollution de l’air et de violents changements climatiques. Les propriétaires de l’aciérie n’ont donc guère de raisons d’augmenter leurs coûts de production de façon à réduire la pollution. “Les changements climatiques représentent la faillite la plus grave des marchés que le monde ait jamais connu”, note Sir Stern.
Toute réforme économique devra donc sanctionner plus sévèrement les pollueurs si l’on veut enrayer la progression du réchauffement planétaire. Certains ont proposé l’imposition d’une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre mais cet “impôt sur le gaz carbonique” se heurte toutefois à une vive opposition dans de nombreux pays et n’a été adopté que par une poignée de pays.
Une autre méthode de quantification de la pollution – le mécanisme d’échange des droits d’émission – a connu plus de succès depuis l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto en 1997. Ce Protocole exige des pays industriels signataires (dont seuls les Etats-Unis et l’Australie ne font pas partie) qu’ils réduisent leur production de gaz à effet de serre d’environ 5 pour cent par rapport aux niveaux des années 1990. Le Protocole a également établi le Mécanisme pour le développement propre de la Conférence-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui autorise les industries les plus polluantes à acheter des droits de pollution de pays peu polluants en échange d’investissements dans les projets écologiques de ces derniers – afin de réduire ainsi le montant des émissions à l’échelle mondiale.
Les transactions de gaz carbonique s’élèvent aujourd’hui à 22 milliards de dollars. L’Afrique espérait bénéficier du faible montant de ses émissions pour attirer les capitaux du Mécanisme pour le développement propre. Ce sera peut-être le cas, mais au milieu de l’année 2007, elle n’avait bénéficié que de moins de 2 pour cent des projets financés par le Mécanisme dans le monde. Ce manque d’intérêt s’explique, d’après les experts, par les conditions généralement peu propices aux investissements qui règnent en Afrique, notamment la pénurie d’organismes financiers et commerciaux performants et l’insuffisance des moyens administratifs et de gestion du continent.
Mais puisque l’accord de Kyoto arrive à échéance en 2012 et qu’il est maintenant prouvé que le réchauffement planétaire est plus rapide que prévu, il n’est pas impossible que le développement vert de l’Afrique profite des réformes économiques nécessaires pour lutter contre le réchauffement planétaire. “On ne dispose que de peu de temps pour enrayer la croissance des émissions de gaz à effet de serre, a déclaré à la presse en mai à Bangkok Rajendra Pachauri, qui préside l’influent Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat établi par les Nations Unies. On ne peut pas se permettre d’attendre.”
ONU Afrique Renouveau
Avis de tempête
Les répercussions des changements climatiques sur la population suscitent de plus en plus d’inquiétudes dans le monde entier, alors que des milliards de tonnes de déchets industriels polluent l’atmosphère chaque année, retenant une trop grande quantité de chaleur solaire et entraînant de dangereux bouleversements du climat et des phénomènes météorologiques de par le monde.
L’Afrique subsaharienne produit moins de 4 pour cent de ces émissions – l

COTEIVOIRE - accès rapides
 Accueil coteivoire
Accueil coteivoire
 Actualites
Actualites
 Arts et Culture
Arts et Culture
 Cuisine
Cuisine
 Economie
Economie
 Education
Education
 Environnement
Environnement
 Musique
Musique
 Peuples - Ethnies
Peuples - Ethnies
 Politique
Politique
 Sante
Sante
 Société
Société
 Sport
Sport



 255
255  0
0